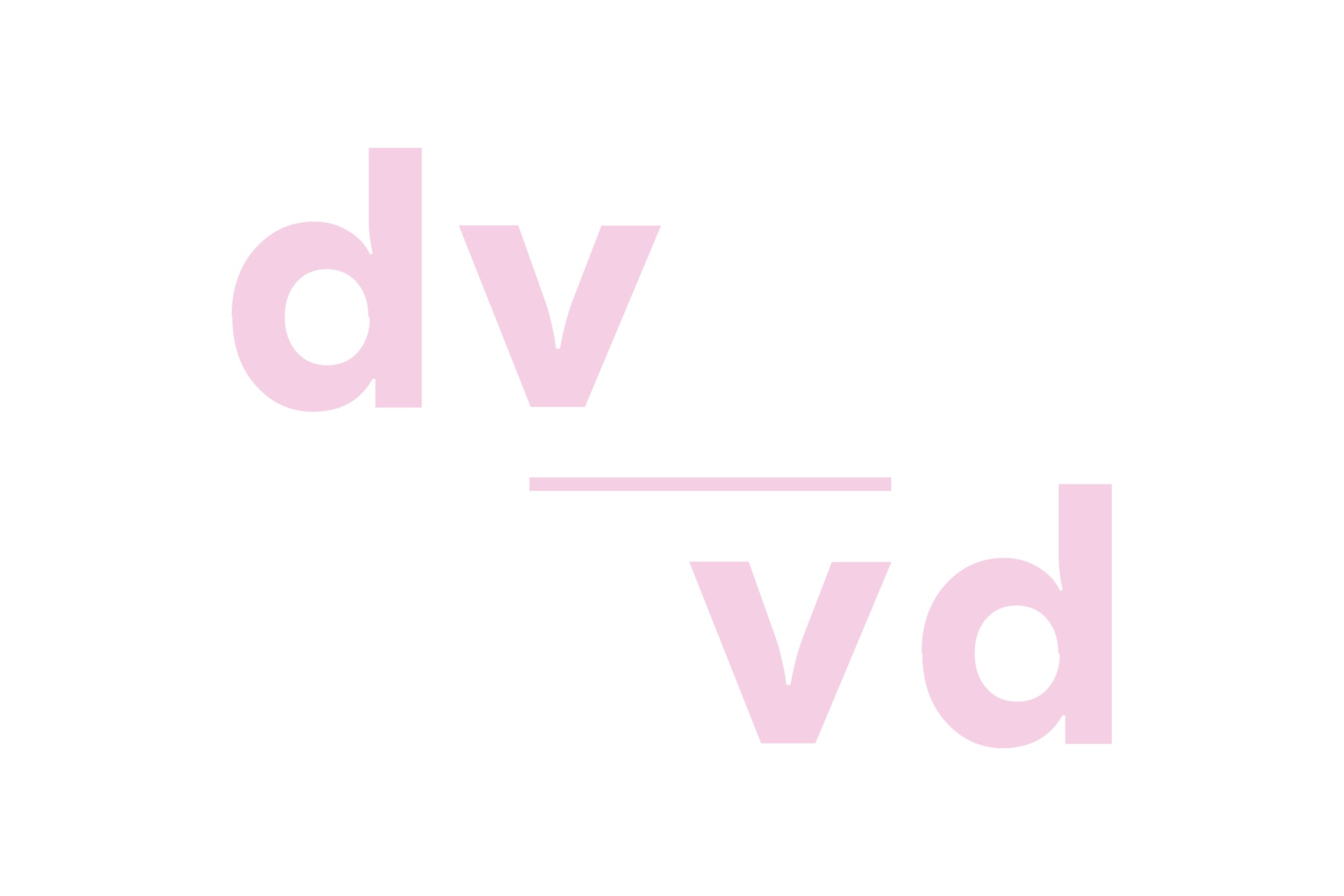Land Back : De la Palestine à l’Ile de la Tortue
Le 27 février 2025 à 19 h
— Évènement Facebook
Les places sont limitées et l'entrée se fera sur le principe du premier arrivé, premier servi. La projection débute à 19 h précise, merci d'arriver quelques minutes à l’avance!
Pour la série dv_vd, Vidéographe et Dazibao ont invité les commissaires Farah Atoui et Muhammad Nour ElKhairy à présenter un programme d'œuvres.
“L’idée de territoire est essentielle à la compréhension des intentions qui motivent le génocide commis par l’état israélien. Pour ce faire, nous devons rompre avec notre perception occidentale du territoire, du lieu et de la propriété. Car pour les Palestiniens, comme pour tous les peuples autochtones, le territoire ne désigne pas le lieu où ils vivent; le territoire est l’essence même de leur identité. Cela crée un conflit inhérent entre Israël qui cherche à l’acquérir, et les Palestiniens pour qui il fait partie intégrante de leur existence. C’est là que se situe ce qui oriente l’État colonisateur vers la nécessité d’éliminer les Autochtones. Voilà pourquoi les déplacements, la dépossession, la destruction culturelle, la dévastation de la souveraineté alimentaire – qui constituent manifestement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en eux-mêmes – doivent également être reconnus comme étant destinés à supprimer l’appartenance culturelle et à détruire le lien des Palestiniens à la terre.”
Land Back réunit un puissant ensemble de voix d’artistes palestiniens et autochtones qui, par l’entremise de leurs œuvres vidéo et cinématographiques expérimentales, confrontent la violence systémique de la dépossession coloniale, du déplacement et de l’anéantissement culturel, tout en revendiquant leurs relations continues avec leurs terres ancestrales. LAND BACK n’est pas une métaphore; c’est un appel à la justice et à la libération ancré dans la décolonisation. Pour les Palestiniens, c’est une revendication du droit au retour des et sur leurs terres ancestrales, à l’égalité et à l’autodétermination à travers le démantèlement de l’occupation israélienne et à l’apartheid, du fleuve à la mer. Pour les peuples autochtones de l’Ile de la Tortue, c’est un appel à la restitution de la souveraineté et de la gestion des terres, fondé sur leurs responsabilités sacrées de prendre soin de leurs territoires et de les préserver. En situant ces luttes dans un cadre commun et en juxtaposant les histoires imbriquées et interconnectées du colonialisme de peuplement et de la résistance en Palestine et sur l’Ile de la Tortue, Land Back met en évidence les revendications communes liées à la terre des Palestiniens et des peuples autochtones, tout en reconnaissant leurs contextes culturels et historiques distincts.
Les œuvres présentées dans le cadre de ce programme explorent les liens profonds entre la terre, l’identité et la présence historique, soulignant qu’une revendication matérielle du territoire est fondamentale dans les luttes anticoloniales. Par le truchement de diverses approches esthétiques – expérimentant avec du texte, des images numériques, des documents d’archives et des photographies, et mobilisant le pouvoir de la poésie et de l’imagerie poétique – ces interventions artistiques proposent des contre-récits dévoilant au grand jour la fiction et les mythes qui sous-tendent les projets coloniaux. S’appuyant sur des expériences vécues et incarnées, puis sur des histoires orales de déplacement et d’exil, ces films se veulent des témoignages qui révèlent la violence des projets coloniaux et du contrôle des frontières, lesquels desseins assimilent le territoire à la carte géographique et tentent de dissocier les pratiques personnelles, culturelles et spirituelles profondément enracinées des personnes qui l’habitent.
La vidéo minimaliste et textuelle réalisée par Muhammad Nour ElKhairy, I Would Like to Visit (2017), s’inspire de son expérience vécue pour exposer la nature oppressive des régimes coloniaux de contrôle des frontières, qui non seulement restreignent la mobilité des Palestiniens, mais rendent également presque impossible la perspective de visiter ou de retourner dans leur pays d’origine. En parallèle, ElKhairy examine avec un regard critique la nature périlleuse du déplacement des Palestiniens vers le Canada, où la recherche d’un refuge et du droit à la mobilité le positionne comme un colon sur des terres autochtones.
Le poème expérimental Canada Park (2020) de Razan Al Salah explore également l’impact du colonialisme de peuplement sur l’identité et la mobilité palestiniennes. En franchissant numériquement les frontières coloniales à partir de Google Street View, Al Salah met en scène un retour improbable en Palestine, où sa présence spectrale plane au-dessus du parc Ayalon-Canada. Ce parc, érigé sur les ruines de villages palestiniens détruits par l’occupation israélienne en 1967 et financé en partie par des contributions du Fonds national juif du Canada, souligne les liens entre les projets coloniaux de peuplement en Palestine et l’ile de la Tortue. En situant leurs récits dans le contexte canadien, les œuvres d’ElKhairy et d’AlSalah ouvrent un espace de réflexion critique sur la solidarité et la résistance commune contre les structures et les projets coloniaux.
L’œuvre untitled part 3b: (as if) beauty never ends... (2000) de Jayce Salloum dépeint l’histoire de la destruction et de l’effacement coloniaux à travers la perspective d’une maison palestinienne réduite en ruines par les forces d’occupation israéliennes en 1967. Cette histoire est narrée de manière poétique avec la voix du propriétaire, lequel a été déplacé de Palestine vers un camp de réfugiés au Liban. Dans la vidéo expérimentale de Salloum, des images abstraites – des orchidées en fleurs, des nuages défilants, de l’eau qui coule – sont superposées à du métrage brut des massacres des camps de réfugiés de Sabra et de Chatila en 1982, et ce, afin de lever le voile sur la réalité poignante du déplacement vers le Liban. Cette juxtaposition, qui crée une confrontation profondément troublante à la violence et à sa représentation, propose un langage visuel alternatif pour appréhender les images du génocide et des atrocités qui se sont déroulées tout au long de l’histoire et continuent de se produire aujourd’hui en Palestine et au Liban.
The Violence of a Civilization Without Secrets (2017) réalisée par Adam Khalil, Zack Khalil et Jackson Polys, constitue également une expérience visuelle troublante. Cette vidéo adopte une approche narrative expérimentale pour mettre en lumière le rôle central qu’ont joué les pratiques archéologiques et les institutions muséales dans l’anéantissement des histoires autochtones et la fabrication de récits coloniaux de découverte et de propriété. En se concentrant sur le cas controversé de l’homme de Kennewick – des restes squelettiques vieux de 9 000 ans trouvés dans le sol du bassin du Columbia – les cinéastes se questionnent à savoir comment le pouvoir colonial fait l’usage de disciplines scientifiques comme arme pour réfuter les revendications autochtones relatives à l’ascendance et au territoire. Ici, le sol incarne un profond sentiment d’appartenance, ancrant les communautés autochtones dans un lieu qui demeure au cœur de leur identité et de leur histoire, profondément enraciné dans la terre elle-même.
Dans Something from there (2020) de Rana Nazzal Hamadeh, la terre devient un support pour raconter l’histoire intime d’un exilé de Palestine au Canada. Tissé à partir d’entretiens avec ses parents et de photos de famille, le film explore la pratique poignante du don de terre de Palestine à ceux et celles qui vivent en exil – un geste qui sert à la fois de lien symbolique et matériel avec la terre qu’ils ont été forcés de quitter et vers laquelle il est souvent impossible de retourner. Cette pratique transcende son symbolisme et sa matérialité, devenant un puissant acte de résistance qui démontre le lien durable et les droits des Palestiniens envers leur patrie, malgré les déplacements intergénérationnels. Comme le dit avec émotion Rehab Nazzal, la mère de Hamadeh, dans Something from there, « la terre est la source de la vie; elle est la vie; elle signifie la vie ».
Faisant écho au travail de Hamadeh, le film expérimental de Nada El-Omari, Yaffa (2019), superpose et surimpressionne avec complexité diverses séquences pour créer un portrait texturé d’un voyage intergénérationnel de déplacement et du souvenir immuable d’une patrie. Par l’entremise d’une narration poétique présentée comme une lettre à son grand-père – déplacé de Yaffa au Canada – El-Omari explore ses « histoires murmurées d’une mer en sang », qui ont profondément façonné son identité, sa mémoire et son lien profond avec la terre et la mer desquelles il a été arraché.
Les trois courts métrages d’Alanis Obomsawin, Wild Rice Harvest Kenora (1979), Farming (1975) et Xusum (1975), mettent en lumière le lien profond qu’entretiennent la nation líl̓wat et le peuple anishinaabe avec leur terre en tant que source vitale de subsistance, de culture et de communauté. Ces films se penchent sur les pratiques communautaires de récolte, d’agriculture et de préparation des aliments, les présentant comme essentielles à l’identité autochtone. Ils soulignent également le rôle crucial que remplit la souveraineté alimentaire, non seulement en tant que moyen de subsistance, mais aussi à titre de nécessité pratique et politique liée à des luttes plus larges, notamment relativement au territoire, à la survie culturelle et à l’autodétermination.
Healing Moments (2023) de Rehab Nazzal se veut une incursion méditative au cœur des paysages de Cisjordanie, réalisée au moyen d’images sensorielles immersives qui mettent en relief la relation spirituelle que les Palestiniens entretiennent avec leur territoire. Elle souligne également la capacité de ce territoire à cultiver la détermination et la guérison malgré la segmentation violente à laquelle il a été soumis par l’entremise des points de contrôle israéliens et du mur de l’apartheid. Ensemble, ces deux œuvres relatent les liens réparateurs qui existent entre les peuples autochtones et leur terre, tout en évoquant les luttes qui perdurent au nom de la souveraineté et de l’appartenance.
Réalisé par TJ Cuthand, Reclamation (2018) agit à titre de conclusion prospective au programme, car il réoriente le récit des luttes du passé et du présent vers ce qui nous attend potentiellement. Ce film imagine un avenir post-dystopique au Canada, où des colons blancs privilégiés ont abandonné la Terre pour Mars, laissant derrière eux une planète dévastée par le colonialisme et le capitalisme. En leur absence, les peuples autochtones se réapproprient le territoire, s’efforçant de restaurer sa vitalité et de guérir les profondes cicatrices infligées par les systèmes coloniaux. Le récit spéculatif de Cuthand met l’accent sur le lien pérenne avec la terre comme source de résilience et de renouveau, tout en concevant un avenir façonné par la décolonisation et la restauration de l’environnement.
Land Back fait valoir les luttes incessantes des peuples autochtones pour leur souveraineté, de la Palestine à l’ile de la Tortue, et met l’accent sur les liens profonds et durables qui les unissent à leurs terres d’origine à travers les générations et la géographie. Ce programme de projection représente une occasion de réfléchir à l’interconnexion des luttes anticoloniales et à l’urgence de créer des projets de solidarité transnationale face aux effets destructeurs et aux répercussions violentes de la colonisation. Il s’agit également d’une invitation à envisager un avenir plus juste et plus prometteur, où la terre ne serait plus une ressource ou une propriété exploitable, mais bien une entité vivante qui soutiendrait culturellement et matériellement l’identité et l’existence des Autochtones. Elle constituerait ainsi le gisement de leurs récits, de leurs connaissances, de leurs pratiques communautaires et de leurs traditions culturelles, portant l’héritage des ancêtres et assurant leur survie.
— Farah Atoui et Muhammad Nour ElKhairy
Programme — 76 minutes
Muhammad Nour ElKhairy, I Would Like to Visit (2017) — 4 min. 25 sec.
Razan Al Salah, Canada Park (2020) — 8 min. 4 sec.
Jayce Salloum, untitled part 3b: (as if) beauty never ends... (2000) — 11 min. 34 sec.
Jackson Polys, Zack Khalil, Adam Khalil, The Violence of a Civilization Without Secrets (2017) — 9 min. 45 sec.
Rana Nazzal Hamadeh, Something from there (2020) — 7 min.
Nada El-Omari, Yaffa (2019) — 7 min.
Alanis Obomsawin, Wild Rice Harvest Kenora (1979) — 1 min.
Alanis Obomsawin, Farming (1975) — 1 min.
Rehab Nazzal, Healing Moments (2023) — 8 min. 28 sec.
Alanis Obomsawin, Xusum (1975) — 4 min.
TJ Cuthand, Reclamation (2018) — 13 min.
-
— 4 min. 25 sec.
Cette œuvre composée d’un court métrage expérimental et d’une installation combine texte et film pour explorer le désir simple de voyager, à travers les réalités culturelles et politiques de l’existence d’un Palestinien. Sur bande sonore créée dans un état d’anxiété dispositionnelle, l’œuvre révèle un gros plan d’un texte tapé et édité sur un logiciel de traitement de texte. Elle complexifie ce désir simple de voyager en y ajoutant les réalités sociales, culturelles et politiques associées au fait d’être Palestinien sur un territoire autochtone de l’ile de la Tortue.
Muhammad Nour Elkhairy est un cinéaste, vidéaste et programmateur de films palestinien originaire de Jordanie qui vit actuellement à Tiohtià:ke (Montréal). ElKhairy est titulaire d’une maitrise en beaux-arts en production cinématographique de l’Université Concordia. Ses œuvres vidéo expérimentales de fiction et de non-fiction se penchent particulièrement sur l’héritage du pouvoir colonial, politique et économique. Son travail est intrinsèquement lié au désir de mettre en valeur l’écran non seulement en tant qu’appareil idéologique, mais aussi comme une surface sur laquelle le moi joué existe entre l’intériorité du personnel et l’extériorité du sociopolitique. Son travail a été présenté dans plusieurs galeries d’art et festivals de cinéma internationaux, notamment le Berwick Film & Media Arts Festival, le Kaunas International Film Festival, le Toronto Palestine Film Festival et la Galerie Leonard & Bina Ellen.
-
— 8 min. 4 sec.
Je marche sur la neige pour atterrir dans le désert. Je me retrouve sur un territoire autochtone non cédé dans ce qu’on appelle le Canada, une exilée incapable de retourner en Palestine. Je franchis la frontière coloniale en tant que spectre numérique flottant dans le parc Ayalon-Canada, transplanté sur trois villages palestiniens rasés par l’occupation israélienne en 1967.
Canada Park est un poème vidéo expérimental qui brosse un tableau de la politique de disparition/d’apparition de la Palestine telle que racontée, cartographiée et imagée dans Google Street View et dans la photographie de paysage colonial du début du 20e siècle de la « Terre sainte », à savoir sur le site d’Imwas, lieu théologiquement confondu avec Emmaüs, un village cité dans la Bible. Imwas est effacé et Emmaüs est marqué comme un site touristique religieux dans le parc, une prophétie scripturale et algorithmique autogénérée.
Ce parc est situé entre ce que l’on appelle communément le No Man’s Land et Jérusalem. Le film explore cet espace absurde de suspension pour créer une contre-mythologie des lieux envers les forces religieuses, géopolitiques et capitalistes ayant actionné leur imaginaire sur la Palestine, son peuple et son territoire en réinsérant les quelques images documentant la Marche du Retour à Latroun du 16 juin 2007. Imwas n’est pas effacé. Il est enterré sous terre, un sous-commun, un ailleurs ici, où le colonialisme n’a plus de sens.
Je me réveille à nouveau, les pieds sur terre dans ce qu’on appelle le Canada, dans un autre parc, en territoire iroquois mohawk. Je marche sur la neige pour atterrir dans le désert.
Razan AlSalah est une artiste et enseignante palestinienne établie à Tiohtià:ke/Montréal. Ses films jouent avec l’esthétique matérielle de l’apparition et de la disparition des corps, des récits et des histoires autochtones dans les mondes de l’image coloniale. Elle travaille fréquemment à partir d’images sonores pour infiltrer les frontières qui nous ont séparés de la terre. Ses œuvres constituent à la fois des intrusions fantomatiques et des ruptures suintantes de l’image coloniale, agissant telle une frontière, tel un mur. AlSalah perçoit son processus créatif comme s’il s’agissait d’un cercle de relations avec les artistes, les amis, la famille, la technologie, les images, les plantes, les objets, les sons… et l’inconnu. Ces relations se mutent en divers points d’entrée et de sortie vers des ailleurs, ici, où le colonialisme n’a plus de sens.
-
— 11 min. 34 sec.
Cette œuvre plus ambiante comporte de nombreux éléments : des orchidées en fleurs et des plantes en croissance, superposées sur du métrage brut filmé après le massacre de 1982 au camp de réfugiés de Sabra et de Chatila au Liban. Des photos de nuages, des images par satellite de Hubble, des coupes transversales de corps visibles et des plans abstraits d’eau au ralenti ajoutent à cette réflexion sur le passé, sur son contexte présent et sur sa trajectoire génocidaire. Grâce à la voix hors champ d’Abdel Majid Fadl Ali Hassan (un réfugié de 1948 vivant dans le camp de Bourg El Barajneh) narrant une histoire racontée par les décombres de sa maison en Palestine, et à la collection d’audio accompagnant les clips, la bande vidéo s’imprègne dans un essai intense sur la dystopie à l’époque contemporaine. Fonctionnant de manière directe, viscérale et métaphorique, la bande vidéo fournit une réponse élégiaque à la dépossession palestinienne en cours.
Jayce Salloum tend à se rendre uniquement là où il est invité ou là où il ressent une affinité intrinsèque, ses projets étant ancrés dans un engagement intime avec le lieu. Petit-fils d’immigrants syriens ou libanais, il est né et a grandi sur la terre des autres, le territoire de Sylix (Okanagan). Après des années passées ailleurs, il s’est installé sur les terres volées et non cédées des xʷməθkʷey̓əm, Sḵwx̱wú7mesh et səíl̓wətaʔł. Reconnaitre et agir en conséquence est une pratique quotidienne, mais de manière réaliste, il constate qu’il pourrait faire beaucoup plus. Dans/hors de ce contexte – pas que cela importe vraiment –, Salloum a donné des conférences, publié et exposé de manière omniprésente dans un large éventail de lieux locaux et internationaux, dont certains improbables, des plus petites vitrines anonymes de son quartier Downtown Eastside de Vancouver aux institutions telles que le Musée du Louvre, le Museum of Modern Art, le Centre Pompidou, le Musée des beaux-arts du Canada, la Biennale de La Havane, la Biennale de Sharjah, la Biennale de Sydney et le Festival international du film de Rotterdam.
-
— 9 min. 45 sec.
Cette œuvre est une réflexion pressante sur la souveraineté autochtone, sur la violence toujours vivante dans les archives muséales et sur la justice post-mortem relativement au cas de « l’homme de Kennewick », un homme paléoaméricain préhistorique dont les restes ont été retrouvés à Kennewick, Washington, en 1996.
Adam Khalil est un cinéaste et artiste qui réside et travaille à Brooklyn. Sa pratique vise à subvertir les formes traditionnelles d’ethnographie par l’humour, la relation et la transgression. Le travail de Khalil a été exposé au Museum of Modern Art, au Sundance Film Festival, au Walker Art Center, au Lincoln Center et au Whitney Museum of American Art, entre autres institutions. Khalil a reçu plusieurs bourses et subventions, notamment la Sundance Art of Nonfiction, la Sundance Institute Indigenous Program, la UnionDocs Collaborative Fellowship et la Gates Millennium Scholars Program. Khalil a obtenu son baccalauréat au Bard College.
Zack Khalil est un cinéaste et artiste originaire de Sault Ste. Marie, dans le Michigan. Il vit actuellement à Brooklyn, dans l’État de New York. Son travail explore généralement une vision du monde autochtone et vient ébranler les formes traditionnelles d’autorité historique à travers l’exploration de récits alternatifs et l’utilisation de formes documentaires innovantes. Il a récemment obtenu un baccalauréat au Bard College en cinéma et en arts électroniques, et il est membre de l’UnionDocs Collaborative Fellow et du Gates Millennium Scholar.
Jackson Polys est un artiste multidisciplinaire appartenant au territoire Tlingit, qui vit et travaille entre ce qu’on appelle aujourd’hui l’Alaska et New York. Il est titulaire d’une maitrise en beaux-arts en arts visuels de l’Université Columbia (2015) et a reçu en 2017 une bourse de mentorat de la Native Arts and Cultures Foundation. Il est l’un des principaux contributeurs de New Red Order (NRO), une société secrète publique qui, avec un réseau interdisciplinaire d’informateurs, coproduit des vidéos, des performances et des installations qui confrontent les désirs d’indigénéité, les tendances coloniales et les obstacles à la croissance et à l’action des Autochtones. Ses œuvres solos et collaboratives ont été présentées au Alaska State Museum, au Anchorage Museum, à Artists Space, au Burke Museum, à e-flux, à la Haus der Kulturen der Welt, au Images Festival, au MIT, au Museum of Contemporary Art Detroit, au Museum of Modern Art, au New York Film Festival, au Park Avenue Armory, au Sundance Film Festival, à UnionDocs, à la Toronto Biennial of Art, au Walker Art Center et au Whitney Museum of American Art, notamment dans le cadre de la Whitney Biennial 2019, entre autres institutions.
-
— 7 min.
Something from there est un court métrage portant sur la substance de nos terres d’origine. En quoi le lien à la terre est-il altéré à la suite d’un déracinement et dans la diaspora? Comment la matière incarne-t-elle les souvenirs et défie-t-elle l’histoire officielle? Telles sont quelques-unes des questions ouvertes posées à travers cette réflexion sur les implications complexes du désir d’un morceau de terre après un déplacement. Vacillant entre les voix des parents de l’artiste, l’un réfugié et l’autre non, le film se veut personnel, mais évoque une expérience palestinienne commune. L’histoire fragmentée de l’exil du père à partir de la Palestine en 1948 constitue le récit directeur. Comme il le mentionne, il n’est jamais retourné depuis, sauf pour une seule journée dans les années soixante. Sa mère, en revanche, a grandi et a vécu en Palestine pendant une grande partie de sa vie (sa contribution au film a été enregistrée sur Zoom alors qu’elle était assise sur une terrasse de sa ville natale). Bien que son histoire ne soit pas la trame centrale du film, il devient clair au fil du récit qu’elle est capable de revenir et de récupérer le « quelque chose de là-bas » auquel on fait référence. Le « quelque chose » n’est jamais nommé, bien qu’il soit au cœur du récit. S’agit-il du sol? D’un morceau de terre? Des restes de nos ancêtres? La distinction entre terre et corps n’est pas faite, et Something from there se concentre plutôt sur le pouvoir de la mémoire et de la matière pour faire revivre une patrie niée et contrer l’impulsion coloniale qui vise à anéantir toute allégation de vie autochtone.
Rana Nazzal Hamadeh est une artiste palestinienne vivant sur la terre algonquine anishinaabe. Ses photographies, films et installations abordent des questions liées au temps, à l’espace, au territoire et au mouvement, proposant des interventions ancrées dans un cadre de décolonisation et utilisant la mémoire et le récit pour s’engager intimement dans des concepts larges. Sa pratique s’inspire des connaissances issues des mouvements populaires, tant en Palestine occupée qu’à travers l’ile de la Tortue. Nazzal Hamadeh est titulaire d’une maitrise en médias documentaires de la Toronto Metropolitan University et réside entre la ville occupée de Ramallah et Ottawa.
-
— 7 min.
Yaffa est un court métrage expérimental où l’espace et le temps s’amalgament pour former les fragments à partir desquels nous créons nos récits. Dans ces fragments d’images, les souvenirs surgissent et les histoires se racontent. C’est à travers notre temps, nos mots, nos explorations et nos espaces communs que j’ai réalisé que mon grand-père m’avait offert une patrie.
Nada El-Omari est une cinéaste et écrivaine d’origine palestinienne et égyptienne établie à Montréal. Sa pratique et ses intérêts de recherche se concentrent sur les transmissions intergénérationnelles de souvenirs, de déplacements et de récits d’appartenance et d’identité qu’elle explore à travers une lentille poétique et hybride. En focalisant sur le processus et les fragments dans le texte, le son et l’image, El-Omari découvre de nouvelles façons de s’autoraconter et de parler d’hybridité et du soi. El-Omari est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts en production cinématographique et d’une maitrise en beaux-arts en cinéma de l’Université York.
-
— 1 min.
Le riz sauvage est une source importante d’alimentation et de revenus pour de nombreux Anishinaabe, qui parcourent parfois des centaines de kilomètres pour récolter cette céréale dans la région de Kenora, en Ontario. Cette œuvre a été réalisée par Alanis Obomsawin dans le cadre de la série de films Canada Vignettes.
Alanis Obomsawin est l’une des réalisatrices autochtones les plus acclamées dans le monde. Elle a intégré l’univers du cinéma par l’intermédiaire de la performance et de la narration. Embauchée par l’ONF comme consultante en 1967, elle a créé un corpus extraordinaire – 50 films à ce jour – dont des documentaires marquants comme Incident at Restigouche (1984) et Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993). La réalisatrice abénakise a reçu de nombreuses distinctions internationales et son travail a été présenté lors d’une rétrospective en 2008 au Museum of Modern Art. « Mon intérêt principal a toujours été l’éducation, affirme Obomsawin, car c’est là que l’on se forge une identité, que l’on apprend à haïr ou à aimer. »
-
— 1 min.
Les pratiques agricoles des habitants de la nation líl̓wat, près de Mount Currie, en Colombie-Britannique, sont présentées dans une séquence d’instantanés qui illustrent la fertilité de leurs terres et le lien profond qu’entretient ce peuple avec son territoire. Ce court métrage s’inscrit dans la série L’il’wata. Au début des années 1970, au début de sa carrière de documentariste, Alanis Obomsawin a visité la nation líl̓wat, la Première Nation des Salish installée dans les terres intérieures de la Colombie-Britannique, et a créé une série de courts métrages qui montrent des récits personnels sur la culture, l’histoire et les connaissances du peuple líl̓wat.
Alanis Obomsawin est l’une des réalisatrices autochtones les plus acclamées dans le monde. Elle a intégré l’univers du cinéma par l’intermédiaire de la performance et de la narration. Embauchée par l’ONF comme consultante en 1967, elle a créé un corpus extraordinaire – 50 films à ce jour – dont des documentaires marquants comme Incident at Restigouche (1984) et Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993). La réalisatrice abénakise a reçu de nombreuses distinctions internationales et son travail a été présenté lors d’une rétrospective en 2008 au Museum of Modern Art. « Mon intérêt principal a toujours été l’éducation, affirme Obomsawin, car c’est là que l’on se forge une identité, que l’on apprend à haïr ou à aimer. »
-
— 8 min. 28 sec.
Cette vidéo fait partie de l’installation multimédia Driving in Palestine qui combine photographie, vidéo, documents imprimés et son. Cette dernière offre un aperçu des structures israéliennes de ségrégation, de confinement, de surveillance et de restriction de la liberté de mouvement qui prolifèrent en Cisjordanie occupée. Capturées à partir de véhicules en mouvement sur les routes palestiniennes entre 2010 et 2020, cette décennie d’images force le public à s’interroger sur le lien entre la répression et l’affaiblissement des peuples autochtones et les tentatives d’expropriation et de destruction de leurs terres.
Rehab Nazzal est une artiste multidisciplinaire d’origine palestinienne partageant son temps entre Montréal et Bethléem, en Palestine. Son travail traite des effets de la violence coloniale sur le corps et l’esprit des peuples colonisés, sur la terre et sur d’autres formes de vie non humaines. Les vidéos, les photographies et les œuvres sonores de Nazzal ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives au Canada et à l’étranger. Elle est actuellement professeure adjointe à l’Université Dar Al-Kalima à Bethléem et a enseigné à la Simon Fraser University, à la Western University et à l’École d’art d’Ottawa. Elle a reçu de nombreux prix au Canada et ailleurs dans le monde.
-
— 4 min.
Sur l’air d’une chanson en langue lil̓wat7úl, ce film présente une femme cuisinant du gwùshum, un dessert stl’atl’imx (líl̓wat) qui constitue une friandise de prédilection. De la récolte du xúsum (noix de lavage ou ronces remarquables) à la fabrication du fouet à partir de feuilles de maïs, un plat à la fois appétissant et impressionnant est créé.
Ce court métrage s’inscrit dans la série L’il’wata. Au début des années 1970, au début de sa carrière de documentariste, Alanis Obomsawin a visité la nation líl̓wat, la Première Nation des Salish installée dans les terres intérieures de la Colombie-Britannique, puis a créé une série de courts métrages qui illustrent des récits personnels sur la culture, l’histoire et les connaissances du peuple líl̓wat.
Alanis Obomsawin est l’une des réalisatrices autochtones les plus acclamées dans le monde. Elle a intégré l’univers du cinéma par l’intermédiaire de la performance et de la narration. Embauchée par l’ONF comme consultante en 1967, elle a créé un corpus extraordinaire – 50 films à ce jour – dont des documentaires marquants comme Incident at Restigouche (1984) et Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993). La réalisatrice abénakise a reçu de nombreuses distinctions internationales et son travail a été présenté lors d’une rétrospective en 2008 au Museum of Modern Art. « Mon intérêt principal a toujours été l’éducation, affirme Obomsawin, car c’est là que l’on se forge une identité, que l’on apprend à haïr ou à aimer. »
-
— 13 min.
Reclamation est un film inspiré du style documentaire, imaginant un avenir post-dystopique au Canada qui résulte des changements climatiques, des guerres, de la pollution et des séquelles laissées par le projet colonial à grande échelle, lequel a maintenant anéanti le territoire. Lorsque les peuples autochtones sont abandonnés après un exode notable de colons blancs, principalement privilégiés, ayant élu domicile sur Mars, les habitants originels de cette terre s’en sortent en tentant de restaurer et de réhabiliter la patrie à laquelle ils ont le sentiment d’appartenir. Empêtrée par la nécessité de s’occuper des réfugiés climatiques du Sud, cette société post-dystopique lutte pour se réinventer en une communauté plus saine. Elle offre la possibilité de guérir des traumatismes communs et d’user des connaissances scientifiques autochtones traditionnelles pour reconquérir le Canada sur le plan environnemental.
Les peuples autochtones présentent les tâches qu’ils accomplissent pour se soigner eux-mêmes, ainsi que prendre soin du Canada et de la Terre. Elles comprennent notamment les projets d’eau potable, de collecte des déchets, d’élimination sécuritaire des rebuts dangereux, de plantation d’arbres, d’animation de cercles et de cérémonies de guérison, de jeux d’équipe et de discussions qui traitent du ressenti qui nous habite lorsqu’on nous abandonne sur ce que les colons blancs considéraient comme une planète mourante et jetable.
Farah Atoui est professeure adjointe au département d’études cinématographiques et d’images en mouvement de l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia. Elle est organisatrice culturelle et professionnelle des médias, spécialisée dans le cinéma contemporain, la vidéo et la culture visuelle, mettant l’accent sur les pratiques de l’image en mouvement du monde arabe. La pratique d’Atoui explore les interventions artistiques produites dans des conditions de lutte et de contrainte – guerre, occupation, colonisation, crise, déplacement – à la fois comme outils et espaces de résistance, ainsi que comme lieux de production de connaissances critiques qui redynamisent la solidarité et les imaginaires entourant la décolonisation. Elle est titulaire d’un doctorat en communication de l’Université McGill, où ses recherches doctorales ont porté sur les documentaires expérimentaux syriens post-2011 en tant que contre-visualisations au régime de représentation de la « crise » des réfugiés. Elle est commissaire d’exposition et programmatrice de films indépendante, et membre des collectifs de projection Regards palestiniens et Regards syriens.
Muhammad Nour Elkhairy est un cinéaste, vidéaste et programmateur de films palestinien originaire de Jordanie qui vit actuellement à Tiohtià:ke (Montréal). ElKhairy est titulaire d’une maitrise en beaux-arts en production cinématographique de l’Université Concordia. Ses œuvres vidéo expérimentales de fiction et de non-fiction se penchent particulièrement sur l’héritage du pouvoir colonial, politique et économique. Son travail est intrinsèquement lié au désir de mettre en valeur l’écran non seulement en tant qu’appareil idéologique, mais aussi comme une surface sur laquelle le moi joué existe entre l’intériorité du personnel et l’extériorité du sociopolitique. Son travail a été présenté dans plusieurs galeries d’art et festivals de cinéma internationaux, notamment le Berwick Film & Media Arts Festival, le Kaunas International Film Festival, le Toronto Palestine Film Festival et la Galerie Leonard & Bina Ellen.
Dazibao remercie les commissaires, les artistes et Vidéographe pour leur généreuse collaboration ainsi que son comité consultatif pour son soutien.
Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal.
Dazibao reconnait être situé sur le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá : ka et que Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, réunissant aujourd'hui une population diversifiée d'autochtones et d'autres peuples. Guidé par une éthique fondée sur le respect, l'écoute et la sensibilisation, Dazibao s'engage à poursuivre sa réflexion sur les défis systémiques et profondément enracinés liés à l'accessibilité et à l'inclusion dans les arts et au-delà, et s'efforce d'appliquer ces réflexions à tous les aspects de ses activités et de sa gouvernance.